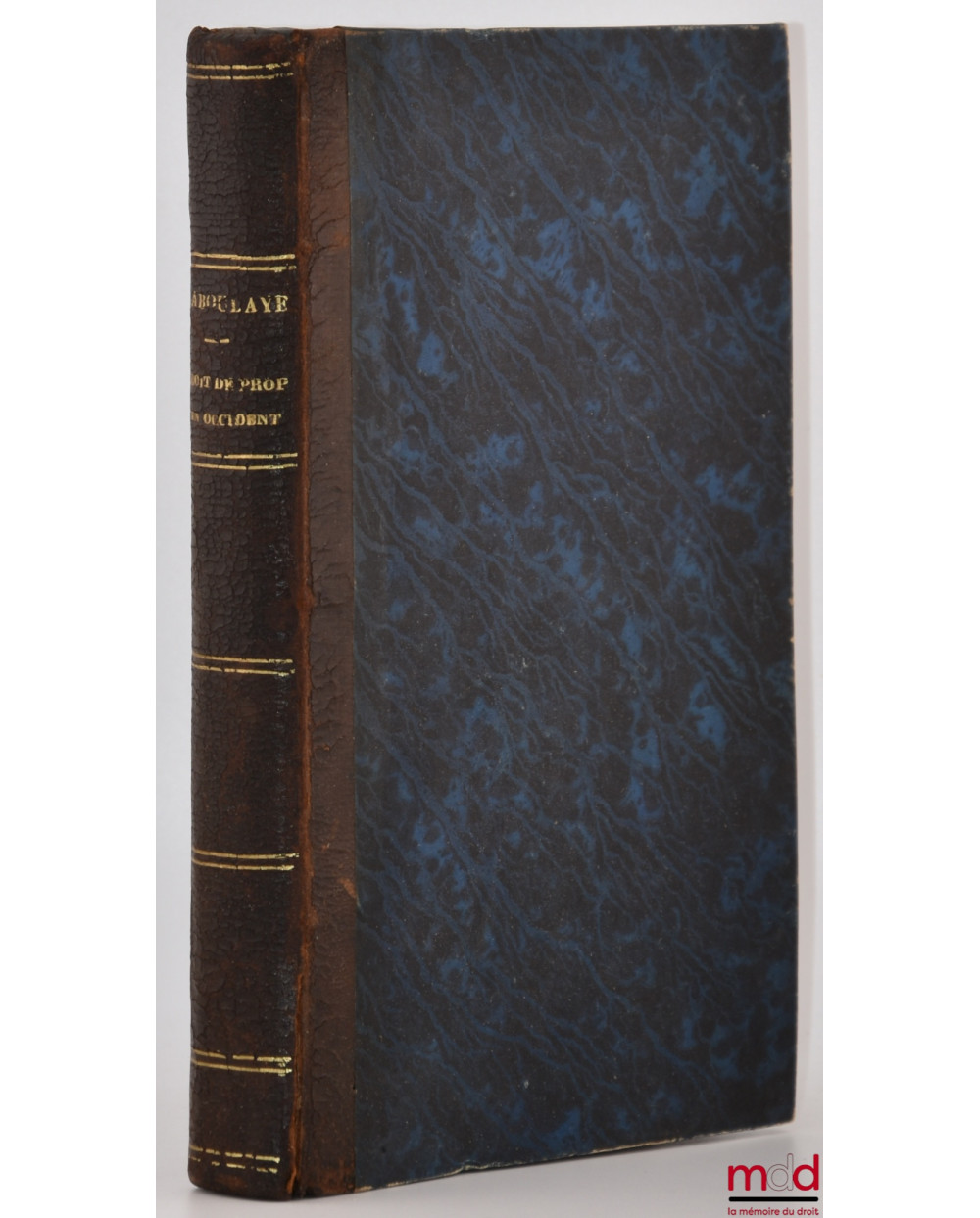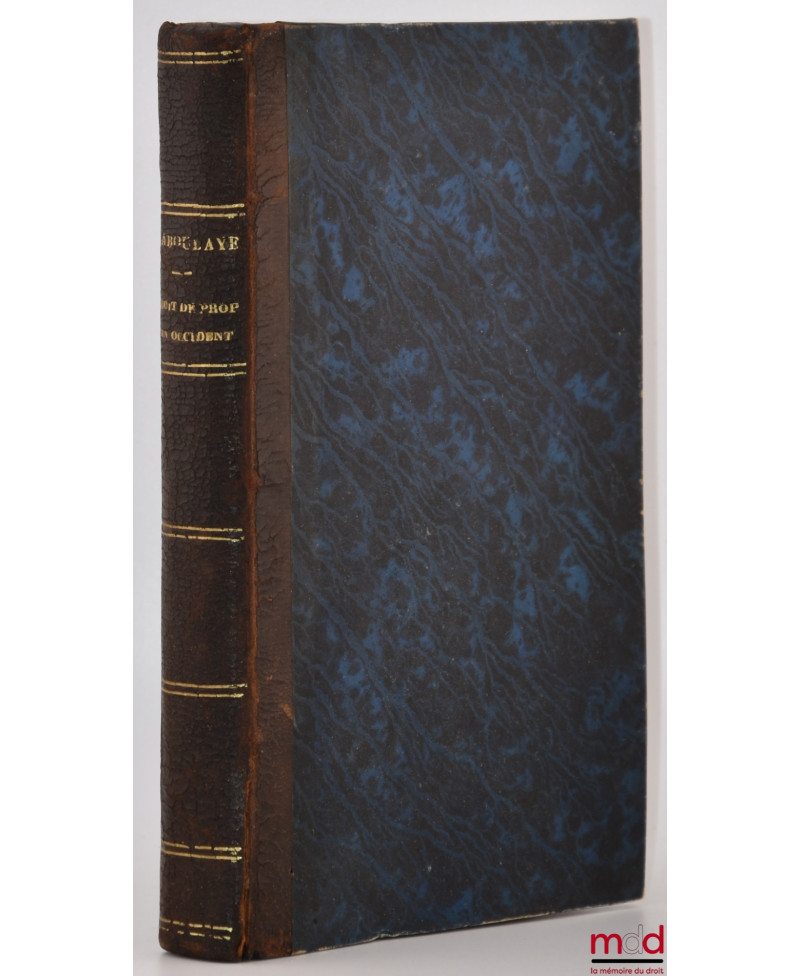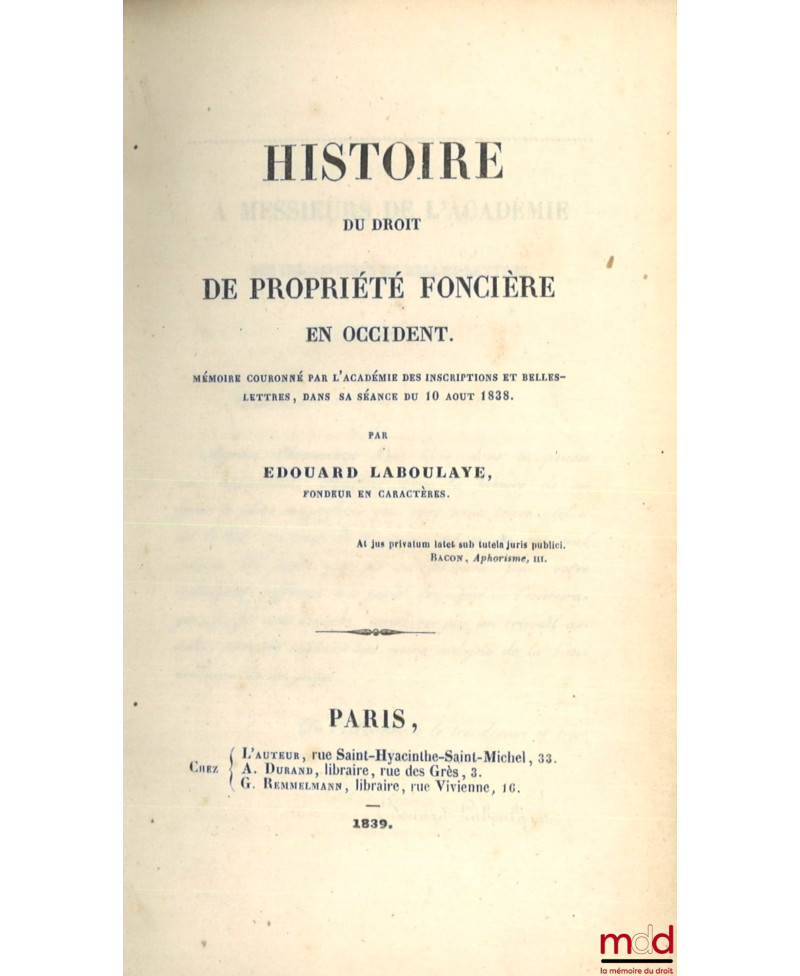LABOULAYE (Édouard)
HISTOIRE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE EN OCCIDENT
Lieu d’édition : Paris
Année d’édition : 1839
Editeur : L’auteur - A. Durand - G. Remmelmann
Description : 3 t. en 1 vol. in-8, demi-chagrin brune, tit. doré sur dos lisse orné de doubles filets dorés soulignants, tr. mouchetées, (rel. vieillie avec craquelure, qq. rousseurs à l’int.), int. frais, XII-532 p.
Ouvrage qui se découpe en deux parties : la première, L’Histoire dix Droit de Propriété chez les Romain ; la seconde, L’Histoire du Droit de Propriété chez les Barbares jusqu’à l’établissement des fiefs. Dans la première partie on remarquera « des points particulièrement intéressants, notamment les chapitres qui traitent de la Distinction de la Propriété et de la Possession, de l’Organisation municipale des derniers temps de l’Empire, de L’Origine du Colonat, institution qui a eu sur le développement du servage une influence encore peu connue, des Lois Julia et Papia Poppœa qui ont bouleversé toute la législation des successions, et ont régné en souveraines pendant presque toute la durée de l’empire. (…) Après quelques considérations sur les premiers Germains, l’auteur examine comment se fil la conquête. Dans l’opinion de l’auteur ce fut moins une invasion du dehors qu’une sorte de prise de possession. Les Barbares s’étaient établis au cœur de l’empire en ruines, et, sous le nom d’auxiliaires et de fédérés, ils en étaient déjà les maîtres. Dans le livre suivant, qui est le sixième, M. Laboulaye expose quelle fut la condition des hommes et des propriétés libres ; il nous montre chaque propriétaire d’alleux souverain dans son domaine et soumis seulement aux trois grandes obligations du canton, l’assemblée ou plaid, la fonction de juge de ses pairs de la guerre ; il nous explique ensuite comment les petits alleux disparurent par l’effet des vassalités, et, à cette occasion, il reprend en sous-œuvre le beau travail de M. Guizot, et expose ce que c’était que la Recommandation et le Précaire ; il essaie de prouver que la Recommandation était la forme même de la vassalité et non point une institution différente, comme paraît l’avoir pensé l’illustre historien. Dans le septième livre l’auteur revient sur cette question des vassalités ; il nous peint sous un triple aspect le roi barbare : chef militaire pour les hommes libres, espèce de préfet romain pour les anciens habitants, seigneur féodal pour tous les hommes qui se sont faits ses vassaux, et il nous montre comment cette dernière qualité finit, par absorbe) : les deux autres, Viennent ensuite les immunités et surtout les immunités ecclésiastiques à qui nous devons peut être la renaissance des villes et la conservation de la civilisation. M. Laboulaye explique ce qu’on doit entendre parle mot de bénéfice, expression complexe qui a été lu cause de grandes méprises historiques, faute de s’être rendu en compte exact des idées différentes que ce mot a exprimées ; H nous dit également cruelle fui lu condition des bénéficiaires : comment ces bénéfices firent la grandeur el la fortune des maires du palais ; comment enfin ces bénéfices, devenus héréditaires et changés en fiefs, amenèrent la féodalité. Le sujet, on le voit, tient au cœur même de l’histoire de France, et sert de supplément nécessaire à tous les ouvrages où l’on s’est borné au récit des faits. Le huitième livre traite de la propriété germaine dans ses rapports avec le droit privé, c’est-à-dire des différents caractères légaux de la propriété, et des formes suivant lesquelles elle se transmettait ; le dernier chapitre nous montre comment l’alleu s’est transformé en fief sans perdre son caractère, et comment il a été vrai de dire que la couronne de France (alleu devenu fief) devait se gouverner par la loi salique qui était la loi des alleux. Le neuvième livre nous dépeint la famille germaine, la tutelle des femmes, le Régime des biens durant le mariage, le Douaire, le Morgengabe ou don du matin que le mari donnait à la femme pour prix de sa virginité, in pretium pulchritudinis, la Dot, etc. L’auteur nous dit ensuite en quels points la succession chez les Germains différait de la succession romaine, différence qui subsiste encore dans nos législations modernes. Il nous expose l’origine de la Représentation, qui ne fut admise qu’à la suite d’un combat ordonné par l’empereur Othon, combat dans lequel le champion des neveux renversa le champion de l’oncle, à la grande satisfaction de tous les neveux futurs ; il explique enfin comment sous l’influence des idées romaines, on en vint, à l’aide des formules, à introduire l’usage des testaments, usage antipathique au génie germain, qui ne reconnaissait qu’à Dieu seul le droit de faire un héritier. Enfin, dans un dernier livre qui n’est pas le moins curieux de l’ouvrage, l’auteur о mis à contribution le Polyptique ďlrminon, publié, il y a quelques années, par notre savant confrère, M. Guérard, pour nous dire quelle fut la condition des serfs à cette époque de confusion qui précède la féodalité. Toute cette partie entièrement neuve est d’un puissant intérêt. Ou voit déjà dans celle condition misérable, le germe d’un meilleur avenir ; on sent que le christianisme a passé par là, et que, tandis que les Romains, pendant huit siècles, n’ont vu clans l’esclave qu’une chose, les Barbares, sous l’influence des idées religieuses, ont fait de l’esclave un homme et presqu’un compagnon. »
Keywords : Droit des biens Droit ancien - Histoire du droit
Ouvrage qui se découpe en deux parties : la première, L’Histoire dix Droit de Propriété chez les Romain ; la seconde, L’Histoire du Droit de Propriété chez les Barbares jusqu’à l’établissement des fiefs. Dans la première partie on remarquera « des points particulièrement intéressants, notamment les chapitres qui traitent de la Distinction de la Propriété et de la Possession, de l’Organisation municipale des derniers temps de l’Empire, de L’Origine du Colonat, institution qui a eu sur le développement du servage une influence encore peu connue, des Lois Julia et Papia Poppœa qui ont bouleversé toute la législation des successions, et ont régné en souveraines pendant presque toute la durée de l’empire. (…) Après quelques considérations sur les premiers Germains, l’auteur examine comment se fil la conquête. Dans l’opinion de l’auteur ce fut moins une invasion du dehors qu’une sorte de prise de possession. Les Barbares s’étaient établis au cœur de l’empire en ruines, et, sous le nom d’auxiliaires et de fédérés, ils en étaient déjà les maîtres. Dans le livre suivant, qui est le sixième, M. Laboulaye expose quelle fut la condition des hommes et des propriétés libres ; il nous montre chaque propriétaire d’alleux souverain dans son domaine et soumis seulement aux trois grandes obligations du canton, l’assemblée ou plaid, la fonction de juge de ses pairs de la guerre ; il nous explique ensuite comment les petits alleux disparurent par l’effet des vassalités, et, à cette occasion, il reprend en sous-œuvre le beau travail de M. Guizot, et expose ce que c’était que la Recommandation et le Précaire ; il essaie de prouver que la Recommandation était la forme même de la vassalité et non point une institution différente, comme paraît l’avoir pensé l’illustre historien. Dans le septième livre l’auteur revient sur cette question des vassalités ; il nous peint sous un triple aspect le roi barbare : chef militaire pour les hommes libres, espèce de préfet romain pour les anciens habitants, seigneur féodal pour tous les hommes qui se sont faits ses vassaux, et il nous montre comment cette dernière qualité finit, par absorbe) : les deux autres, Viennent ensuite les immunités et surtout les immunités ecclésiastiques à qui nous devons peut être la renaissance des villes et la conservation de la civilisation. M. Laboulaye explique ce qu’on doit entendre parle mot de bénéfice, expression complexe qui a été lu cause de grandes méprises historiques, faute de s’être rendu en compte exact des idées différentes que ce mot a exprimées ; H nous dit également cruelle fui lu condition des bénéficiaires : comment ces bénéfices firent la grandeur el la fortune des maires du palais ; comment enfin ces bénéfices, devenus héréditaires et changés en fiefs, amenèrent la féodalité. Le sujet, on le voit, tient au cœur même de l’histoire de France, et sert de supplément nécessaire à tous les ouvrages où l’on s’est borné au récit des faits. Le huitième livre traite de la propriété germaine dans ses rapports avec le droit privé, c’est-à-dire des différents caractères légaux de la propriété, et des formes suivant lesquelles elle se transmettait ; le dernier chapitre nous montre comment l’alleu s’est transformé en fief sans perdre son caractère, et comment il a été vrai de dire que la couronne de France (alleu devenu fief) devait se gouverner par la loi salique qui était la loi des alleux. Le neuvième livre nous dépeint la famille germaine, la tutelle des femmes, le Régime des biens durant le mariage, le Douaire, le Morgengabe ou don du matin que le mari donnait à la femme pour prix de sa virginité, in pretium pulchritudinis, la Dot, etc. L’auteur nous dit ensuite en quels points la succession chez les Germains différait de la succession romaine, différence qui subsiste encore dans nos législations modernes. Il nous expose l’origine de la Représentation, qui ne fut admise qu’à la suite d’un combat ordonné par l’empereur Othon, combat dans lequel le champion des neveux renversa le champion de l’oncle, à la grande satisfaction de tous les neveux futurs ; il explique enfin comment sous l’influence des idées romaines, on en vint, à l’aide des formules, à introduire l’usage des testaments, usage antipathique au génie germain, qui ne reconnaissait qu’à Dieu seul le droit de faire un héritier. Enfin, dans un dernier livre qui n’est pas le moins curieux de l’ouvrage, l’auteur о mis à contribution le Polyptique ďlrminon, publié, il y a quelques années, par notre savant confrère, M. Guérard, pour nous dire quelle fut la condition des serfs à cette époque de confusion qui précède la féodalité. Toute cette partie entièrement neuve est d’un puissant intérêt. Ou voit déjà dans celle condition misérable, le germe d’un meilleur avenir ; on sent que le christianisme a passé par là, et que, tandis que les Romains, pendant huit siècles, n’ont vu clans l’esclave qu’une chose, les Barbares, sous l’influence des idées religieuses, ont fait de l’esclave un homme et presqu’un compagnon. »
Data sheet
- Lieu d’édition
- Paris
- Année d’édition
- 1839
- Date d’édition
- 1839-01-01
- Editeur
- L’auteur - A. Durand - G. Remmelmann
- Description
- 3 t. en 1 vol. in-8, demi-chagrin brune, tit. doré sur dos lisse orné de doubles filets dorés soulignants, tr. mouchetées, (rel. vieillie avec craquelure, qq. rousseurs à l’int.), int. frais, XII-532 p.
No customer reviews for the moment.